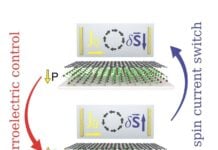Une épidémie dévastatrice de grippe aviaire (grippe aviaire) a anéanti environ la moitié de la population reproductrice d’éléphants de mer femelles sur l’île de Géorgie du Sud, un lieu de reproduction essentiel pour l’espèce. De nouvelles recherches révèlent un déclin de la population de 47 % depuis 2022, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la stabilité à long terme de ce mammifère emblématique de l’Antarctique.
L’ampleur de la crise
L’île de Géorgie du Sud abrite plus de 54 % de la population reproductrice mondiale d’éléphants de mer du sud, ce qui rend l’événement de mortalité particulièrement alarmant. Les chercheurs du British Antarctic Survey ont utilisé l’imagerie aérienne pour comparer les effectifs reproducteurs de 2022 à 2024, révélant l’ampleur catastrophique de la perte : environ 53 000 femelles ont péri.
L’impact s’étend au-delà de la mortalité directe. L’étude suggère que les femelles stressées pourraient avoir abandonné leurs petits, ce qui entrave encore davantage leur rétablissement. La souche hautement pathogène H5N1, initialement détectée en Europe avant de se propager aux Amériques, a atteint la Géorgie du Sud en 2023, même si l’ampleur des dégâts n’est devenue claire qu’avec cette analyse récente.
Pourquoi c’est important
La propagation rapide du H5N1 parmi les espèces d’oiseaux et de mammifères de la région Antarctique constitue une menace croissante. Même si l’impact initial du virus sur la Géorgie du Sud a été sous-estimé en raison de l’éloignement de l’île, les résultats actuels soulignent le besoin urgent d’une surveillance intensive.
La perte de près de la moitié de la population reproductrice est particulièrement préoccupante étant donné le lent taux de reproduction de l’éléphant de mer : les femelles mettent trois à huit ans pour commencer à se reproduire. Le virus continue de circuler, comme en témoigne la baisse du nombre de petits en 2024 par rapport à l’année précédente.
Implications plus larges
L’épidémie met en évidence la vulnérabilité des écosystèmes de l’Antarctique aux maladies infectieuses émergentes. La souche H5N1 a déjà causé des pertes dévastatrices dans les colonies d’oiseaux marins au Royaume-Uni et dans les populations d’otaries en Amérique du Sud, faisant craindre son impact plus large sur la chaîne alimentaire de l’Antarctique.
« Les résultats de cette étude sont déchirants », a déclaré le Pr Ed Hutchinson, virologue à l’Université de Glasgow. « On ne sait pas exactement quelle sera la gravité de l’impact de ce virus sur les autres espèces de mammifères et d’oiseaux de l’Antarctique et du sous-Antarctique. »
La situation exige une surveillance continue pour comprendre les effets à long terme du virus et prévenir de nouvelles épidémies. La crise actuelle nous rappelle brutalement l’interdépendance des écosystèmes mondiaux et le besoin urgent de stratégies proactives de gestion des maladies dans les régions vulnérables.
La perte de près de la moitié de la population femelle reproductrice a de graves implications pour la stabilité future de l’espèce, soulignant le besoin urgent d’une surveillance continue et intensive.