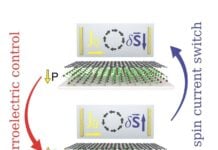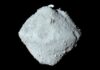Le Brésil parie sur une nouvelle stratégie économique : transformer la biodiversité de la forêt amazonienne en « superaliments » commercialisables et en produits durables. Cette initiative vise à équilibrer la protection de l’environnement avec le développement économique régional, en présentant un modèle potentiel sur la manière d’exploiter les ressources naturelles sans répéter les schémas de déforestation passés.
La promesse d’une richesse inexploitée
Pendant des décennies, l’Amazonie a été exploitée pour le bois, l’élevage de bétail et l’agriculture, entraînant d’importantes pertes de forêts et des émissions de carbone. Le Brésil tente désormais de changer de cap. Des entreprises comme Mahta sont pionnières dans l’extraction et la transformation de fruits moins connus comme le cupuaçu, le taperebá et le bacaba – des ingrédients riches en antioxydants, en fibres et en graisses saines. L’objectif est de créer une « bioéconomie » où la récolte et la transformation durables génèrent des revenus pour les communautés locales tout en préservant la forêt tropicale.
De la forêt au marché : le défi de l’échelle
Le concept est simple : transformer les ressources inexploitées de l’Amazonie en produits de grande valeur destinés aux marchés mondiaux. La clé réside dans les techniques de conservation. La lyophilisation des fruits crus en poudre permet une expédition efficace et maintient la valeur nutritionnelle, conservant ainsi les avantages économiques au Brésil. Cependant, la mise à l’échelle de ce modèle présente des défis. L’Açaí, une baie autrefois obscure, se vend désormais à des prix élevés sur les marchés occidentaux (jusqu’à 13 dollars pour un smoothie bowl à Londres). Si la demande explose, l’augmentation de la production pourrait déclencher les mêmes problèmes de déforestation que le Brésil tente d’éviter.
Agroforesterie et moyens de subsistance durables
Le succès de cette bioéconomie dépend de la fourniture d’alternatives viables aux pratiques destructrices. L’agroforesterie, où le café ou le cacao est cultivé aux côtés d’arbres indigènes, est une approche. L’entreprise de Sarah Sampaio dans la région d’Apui montre comment les agriculteurs peuvent restaurer les forêts tout en maintenant leurs revenus. En plantant des arbres indigènes à côté des cultures, ils créent de l’ombre, améliorent la santé des sols et procurent un bénéfice écosystémique à long terme.
La bioéconomie dans le plan climatique du Brésil
Le plan d’action national du Brésil pour le climat met fortement l’accent sur la bioéconomie. Le pays vise à quadrupler l’utilisation de biocarburants d’ici 2035, ce qui est controversé car cela pourrait conduire à une expansion non durable des plantations de canne à sucre ou de bois d’œuvre. La clé, soulignent les experts, est une réglementation forte.
Garanties nécessaires pour une croissance durable
Ana Yang, directrice du Centre Environnement et Société à Chatham House, prévient que toutes les transitions biosourcées ne sont pas bénéfiques. S’ils détruisent les habitats ou manquent de responsabilité sociale, ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes initiaux. Une réglementation stricte, la transparence et la participation de la communauté sont essentielles pour garantir la durabilité.
L’avenir des ressources amazoniennes
La stratégie bioéconomique du Brésil n’est pas une solution miracle, mais elle représente un changement potentiel vers une gestion durable des ressources. Le succès de cette approche dépend de la généralisation des pratiques durables, de l’application de réglementations strictes et de la garantie que les bénéfices économiques sont partagés équitablement avec les communautés locales. En cas de succès, ce modèle pourrait servir de modèle à d’autres régions cherchant à concilier développement économique et protection de l’environnement.